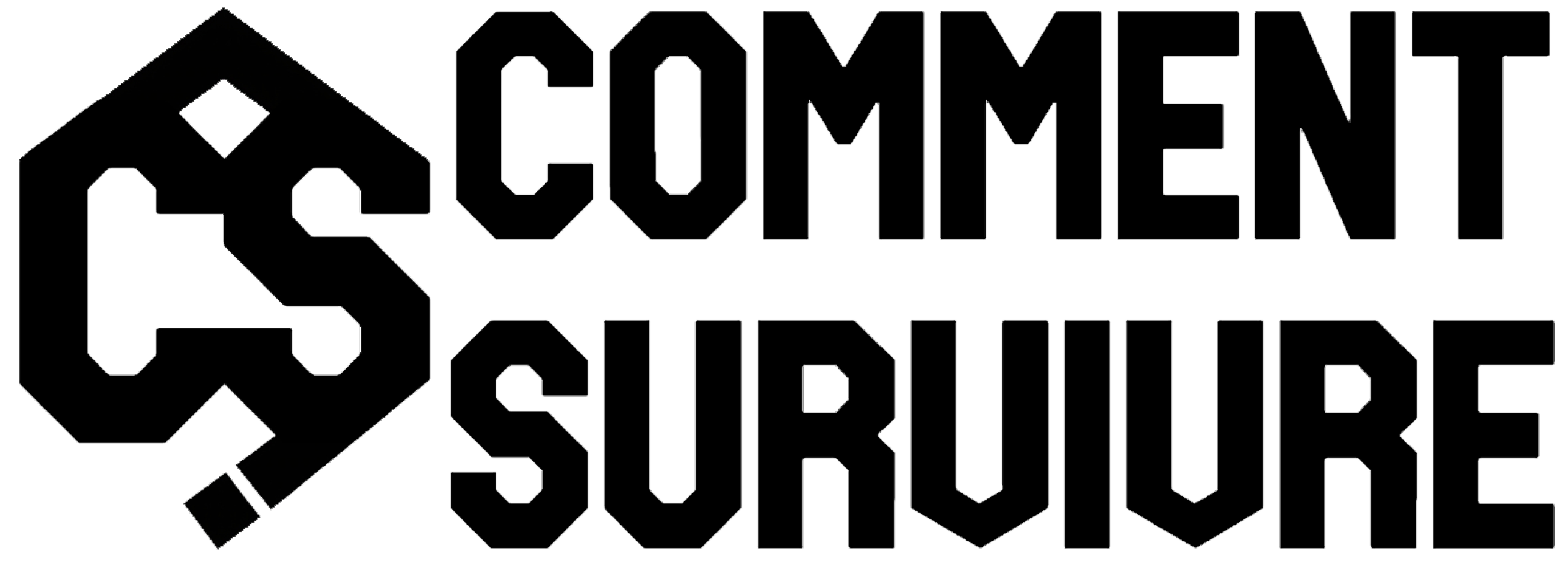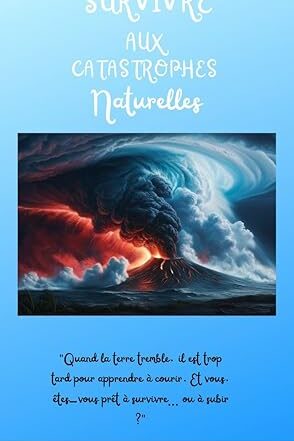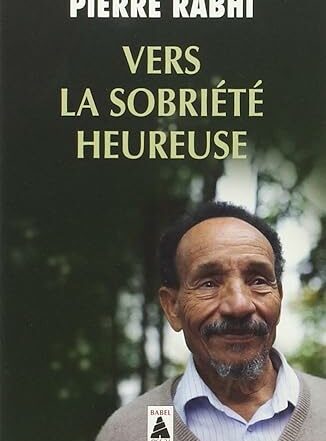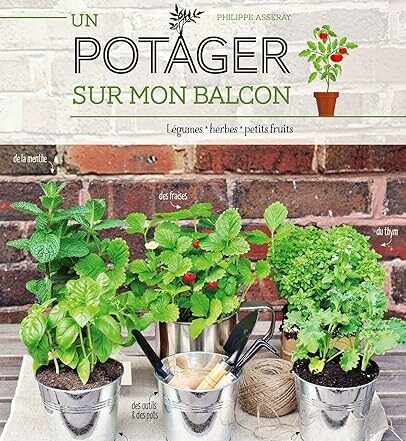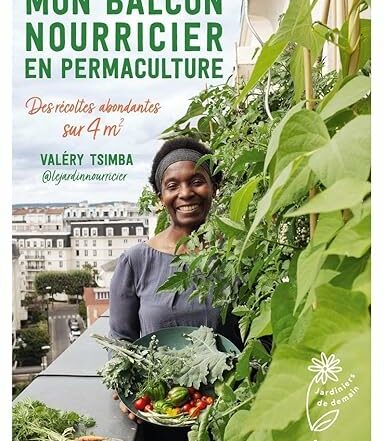Fabriquer son savon en période de crise
Dans un monde où l’autonomie devient une compétence précieuse, fabriquer son savon représente une solution pratique et économique, particulièrement en période de crise. Que ce soit face à des pénuries, des difficultés d’approvisionnement ou simplement par souci d’indépendance, la saponification à froid permet à chacun de créer des produits d’hygiène essentiels avec des ingrédients simples. Cet article explore les techniques, les ingrédients alternatifs et les précautions nécessaires pour réussir son savon maison même quand les ressources sont limitées.
Les bases de la fabrication du savon
La fabrication du savon repose sur un processus chimique appelé saponification. Il s’agit d’une réaction entre un corps gras (huiles ou graisses) et une base forte (généralement de la soude caustique ou de la potasse). Cette réaction transforme les acides gras en savon, libérant également de la glycérine, un humectant naturel bénéfique pour la peau.
Il existe plusieurs méthodes pour fabriquer son savon, mais la plus adaptée en période de crise reste la saponification à froid. Cette technique consiste à mélanger les huiles avec la solution de soude sans apport de chaleur externe, laissant la réaction naturelle faire son œuvre. L’avantage principal est qu’elle nécessite peu d’énergie et préserve les propriétés des ingrédients utilisés.
Pourquoi fabriquer son savon en période de crise ?
En temps de crise, qu’elle soit économique, sanitaire ou environnementale, fabriquer son savon présente de nombreux avantages :
Autonomie et résilience : Ne plus dépendre des chaînes d’approvisionnement commerciales permet de maintenir une hygiène adéquate même quand les magasins sont vides ou inaccessibles.
Économie : À long terme, produire ses propres savons revient moins cher que d’acheter des produits industriels, particulièrement quand les prix s’envolent en période d’incertitude.
Adaptation aux ressources disponibles : La fabrication artisanale permet d’utiliser ce qui est à disposition localement, comme des graisses animales ou des huiles végétales de récupération.
Qualité contrôlée : L’artisan savonnier connaît exactement la composition de son produit et peut l’adapter à ses besoins spécifiques ou aux conditions particulières (eau rare, peau sensible, etc.).
Valeur d’échange : Dans une économie perturbée, les savons faits maison peuvent devenir une monnaie d’échange précieuse contre d’autres biens essentiels.

Les ingrédients essentiels et leurs alternatives
La soude caustique
La soude caustique (hydroxyde de sodium, NaOH) est l’ingrédient indispensable pour la saponification à froid. En période de crise, elle peut devenir difficile à trouver. Voici quelques alternatives :
- Récupération de produits ménagers : Certains déboucheurs de canalisations contiennent de la soude pure. Il faut vérifier attentivement la composition (idéalement 100% hydroxyde de sodium).
- Cendres de bois : Les anciens fabriquaient leur lessive en faisant percoler de l’eau à travers des cendres de bois dur (chêne, hêtre). Le liquide obtenu, riche en potasse, peut remplacer la soude pour faire du savon mou.
- Potasse caustique : L’hydroxyde de potassium (KOH) est utilisé traditionnellement pour les savons liquides et peut remplacer la soude, avec des ajustements dans les quantités (environ 40% plus de KOH que de NaOH).
Les corps gras
En situation normale, on privilégie les huiles végétales comme l’olive, la coco ou le palme. En période de crise, d’autres options s’offrent à nous :
- Graisses animales récupérées : Suif (bœuf), saindoux (porc) ou graisse de volaille peuvent être purifiés et utilisés comme base pour les savons.
- Huiles de cuisson usagées : Après filtration soigneuse pour éliminer les particules alimentaires, ces huiles peuvent être saponifiées. Le savon aura une odeur plus prononcée et une couleur plus foncée.
- Beurres végétaux de récupération : Beurre de cacao ou de karité périmés pour l’alimentation mais encore utilisables pour la cosmétique.
Les additifs et personnalisation
Pour enrichir le savon, de nombreux ingrédients peuvent être trouvés localement :
- Plantes médicinales séchées et réduites en poudre
- Argiles pour leurs propriétés absorbantes et purifiantes
- Miel comme agent humectant et antibactérien
- Sel marin pour durcir le savon et créer un effet exfoliant
- Huiles essentielles pour leurs propriétés antimicrobiennes et leur parfum (si disponibles)
- Infusions de plantes en remplacement partiel de l’eau

Équipement nécessaire et solutions de fortune
La fabrication du savon requiert quelques équipements spécifiques, mais en période de crise, l’improvisation devient souvent nécessaire.
Équipement idéal :
- Balance de précision (à 1g près minimum)
- Thermomètre résistant aux produits caustiques
- Récipients en verre, inox ou plastique PEHD (#2)
- Mixeur plongeant
- Moules en silicone ou en bois tapissé de papier sulfurisé
- Protections : gants, lunettes, vêtements longs
Solutions alternatives en situation de crise :
- Balance : Une balance mécanique de cuisine peut suffire avec un peu de précaution
- Thermomètre : Observer la consistance des huiles (solides/liquides) peut remplacer la prise de température exacte
- Récipients : Éviter absolument l’aluminium avec la soude. Des contenants de récupération en plastique épais peuvent convenir pour le mélange des huiles
- Mixeur : Un fouet manuel demande plus d’effort mais fonctionne
- Moules : Boîtes de conserve découpées, briques de lait tétrapack ouvertes, tiroirs en bois
- Protection : Plusieurs couches de sacs plastiques pour les mains, masque de fortune avec tissu épais
Méthode pas à pas pour fabriquer son savon à froid
Voici une méthode simplifiée adaptée aux conditions de crise :
1. Préparation et mesures
La personne commence par peser précisément tous ses ingrédients. La précision est cruciale car un excès de soude rendrait le savon caustique et dangereux, tandis qu’un manque de soude laisserait des huiles non saponifiées, rendant le savon rancissable.
Pour une recette de base en temps de crise :
- 1000g de matières grasses (combinaison d’huiles/graisses disponibles)
- Soude caustique (NaOH) : calculée selon les corps gras utilisés*
- Eau : 2,5 à 3 fois le poids de soude
*Le calcul de la quantité exacte de soude nécessite de connaître l’indice de saponification de chaque huile. En l’absence d’internet, il est recommandé de mémoriser ou noter sur papier quelques valeurs de base :
- Huile d’olive : environ 134g de soude pour 1kg
- Huile de coco : environ 183g de soude pour 1kg
- Graisse de bœuf : environ 140g de soude pour 1kg
- Huile de tournesol : environ 134g de soude pour 1kg
En période de crise, on peut ajouter une « surgraine » de 5-8% (réduction équivalente de la soude calculée) pour s’assurer qu’il ne reste pas de soude libre dans le savon final.
2. Préparation de la solution de soude
La personne verse la soude dans l’eau (jamais l’inverse !) progressivement en mélangeant dans un endroit bien ventilé. La réaction est fortement exothermique et dégage des vapeurs irritantes. La solution peut atteindre 80-90°C. Elle doit la laisser refroidir à environ 40-45°C avant utilisation.
En l’absence de thermomètre, elle peut attendre que le contenant soit tiède au toucher extérieur (sans jamais toucher directement la solution).
3. Préparation des matières grasses
Parallèlement, elle fait fondre les graisses solides à feu doux, puis les mélange aux huiles liquides. L’idéal est que ce mélange soit à une température proche de celle de la solution de soude (35-45°C).
4. Le processus de saponification
Une fois les deux préparations à température similaire, elle verse lentement la solution de soude dans les huiles (pas l’inverse) tout en mélangeant continuellement. Elle poursuit ce mélange jusqu’à atteindre la « trace » – moment où le mélange s’épaissit suffisamment pour laisser une trace persistante à la surface quand on soulève le mixeur ou la cuillère.
Cette étape peut prendre de 5 minutes (avec un mixeur) à 45 minutes (mélange manuel), selon les huiles utilisées.
5. Ajout des additifs éventuels
À la trace légère, c’est le moment d’incorporer les additifs : argiles, herbes, huiles essentielles, etc. Un mélange rapide suffit pour les intégrer.
6. Moulage et isolation
Elle verse ensuite la préparation dans les moules préparés, en tapotant pour éliminer les bulles d’air. Elle recouvre d’une planche puis de couvertures ou tissus épais pour isoler et maintenir la chaleur qui permettra à la saponification de se poursuivre.
7. Démoulage et cure
Après 24 à 48 heures, le savon peut être démoulé et coupé en barres. Cependant, il n’est pas encore prêt à l’usage. La saponification se poursuit pendant plusieurs semaines, et l’eau s’évapore progressivement, durcissant le savon.
En situation de crise, on peut utiliser le savon après 2-3 semaines de séchage, bien que 4-6 semaines soient idéales pour obtenir un savon doux et durable.

Précautions de sécurité à respecter
Même en situation d’urgence, certaines précautions restent non négociables :
- Manipuler la soude avec une extrême prudence : elle peut causer des brûlures graves
- Travailler dans un espace ventilé, loin des enfants et animaux
- Étiqueter clairement tous les contenants et les savons en cure
- Garder du vinaigre à portée de main pour neutraliser d’éventuelles éclaboussures de soude
- Ne jamais utiliser d’ustensiles en aluminium qui réagiraient avec la soude
- Vérifier le pH du savon avant utilisation (avec du papier pH si disponible, ou en testant sur la langue – une sensation de picotement indique un savon encore caustique)
Conservation et utilisation des savons
En période de crise, la conservation optimale des savons devient primordiale :
- Faire sécher complètement les savons avant stockage (minimum 4 semaines)
- Stocker dans un endroit sec, idéalement sur une grille pour que l’air circule
- Utiliser des porte-savons drainants pour prolonger la durée de vie pendant l’utilisation
- Couper les pains en petits morceaux pour n’utiliser que la quantité nécessaire
Pour maximiser la durée de vie d’utilisation :
- Laisser sécher le savon entre chaque usage
- Éviter le contact direct avec l’eau stagnante
- Utiliser les restes et chutes pour faire des savons liquides en les faisant dissoudre dans de l’eau chaude
Recettes adaptées aux situations de crise
Savon basique de survie (100% suif ou saindoux)
Ce savon utilise uniquement de la graisse animale, souvent plus facile à trouver en situation de crise :
- 1000g de suif purifié
- 140g de soude caustique
- 420g d’eau
- Optionnel : quelques gouttes d’huiles essentielles antiseptiques si disponibles
Savon « tout-usage » avec huiles recyclées
- 700g d’huiles de cuisson filtrées
- 300g de graisse animale (si disponible)
- ~135g de soude caustique (calculer selon les huiles exactes)
- 400g d’eau
- 2 cuillères à soupe de sel (pour durcir le savon)
Savon médicinal de fortune
- 800g d’huile d’olive (ou autre huile disponible)
- 200g de cire d’abeille (réduit la quantité de soude nécessaire)
- ~100g de soude caustique
- 300g d’infusion concentrée de plantes médicinales (remplaçant l’eau)
- Poudre d’argile si disponible
Questions fréquentes
Q : Comment savoir si mon savon est sûr à utiliser sans équipement de test ? R : Un savon correctement curé (4-6 semaines) ne devrait plus être caustique. On peut tester en humidifiant légèrement le savon et en le touchant du bout de la langue – une sensation de picotement indique qu’il faut prolonger la cure. Une autre méthode consiste à frotter le savon humide entre les doigts – une sensation glissante sans irritation est bon signe.
Q : Puis-je fabriquer du savon sans soude caustique pure ? R : La solution traditionnelle consiste à utiliser de la lessive de cendres, obtenue en filtrant de l’eau à travers des cendres de bois dur. Cette méthode est moins précise et produit plutôt un savon mou, mais elle fonctionne en l’absence d’alternatives.
Q : Comment conserver mes savons longtemps en période de pénurie ? R : Un savon bien sec, stocké dans un lieu frais et aéré, peut se conserver plusieurs années sans perdre ses propriétés. L’envelopper dans du papier respirant (jamais du plastique) et le placer dans des boîtes en bois ou carton avec des herbes séchées répulsives (lavande, thym) protège contre l’humidité et les insectes.
Q : Comment purifier des graisses animales ou des huiles usagées pour la savonnerie ? R : Pour les graisses animales, faire fondre à feu doux, filtrer les impuretés, puis faire bouillir avec de l’eau. Laisser refroidir et solidifier, puis retirer la couche de graisse purifiée. Pour les huiles usagées, filtrer plusieurs fois à travers un tissu fin, puis mélanger avec de l’eau chaude, agiter, laisser reposer et séparer.
Conclusion
En conclusion, fabriquer son savon en période de crise n’est pas seulement une nécessité pratique, mais aussi un retour aux savoirs traditionnels qui ont permis à nos ancêtres de maintenir leur hygiène avec des moyens limités. En maîtrisant ce savoir-faire, la personne acquiert une autonomie précieuse face aux perturbations des chaînes d’approvisionnement modernes. Si les conditions idéales ne sont pas réunies, l’adaptation et la créativité permettent néanmoins d’obtenir un produit fonctionnel, sinon parfait. Dans un monde incertain, les compétences pratiques comme la fabrication du savon représentent une forme de résilience à la portée de chacun